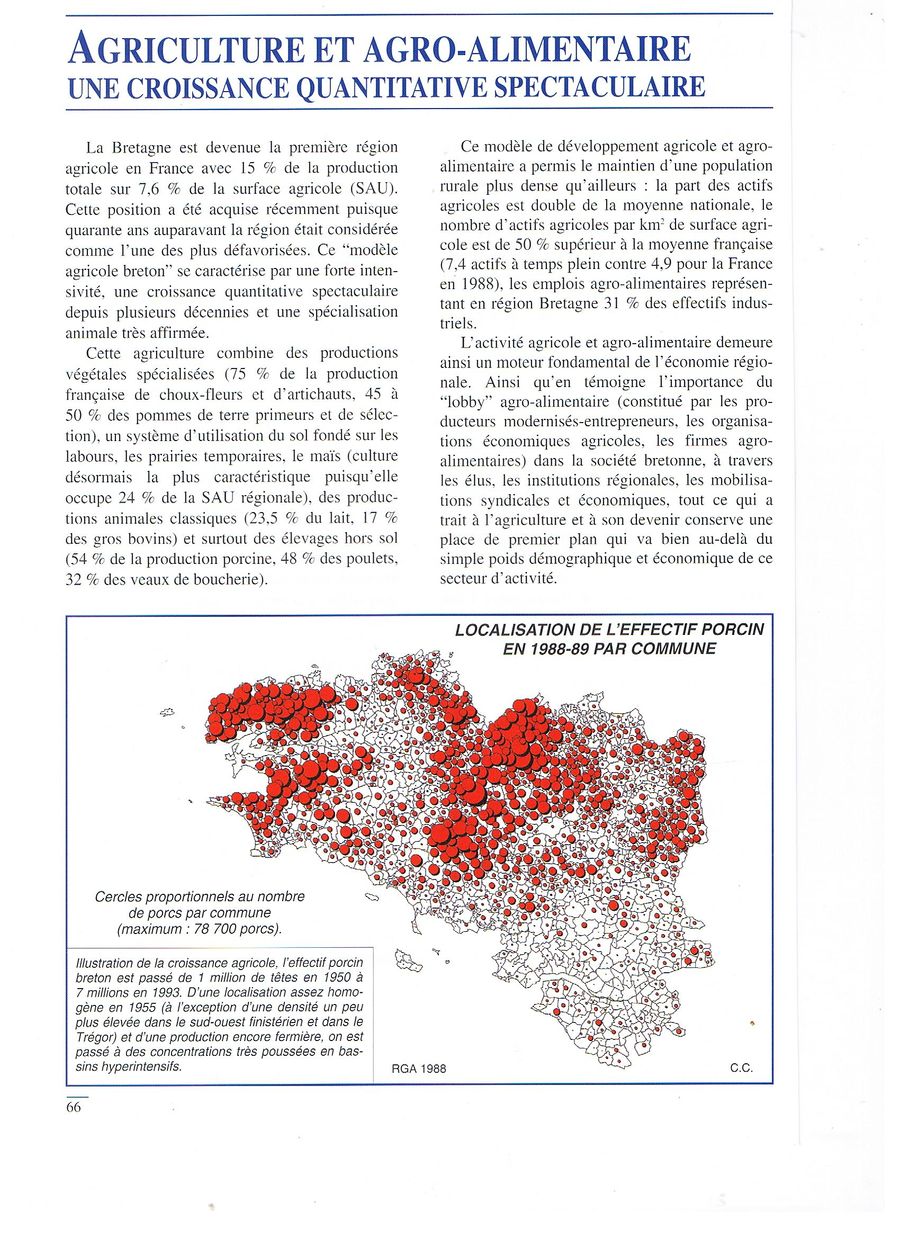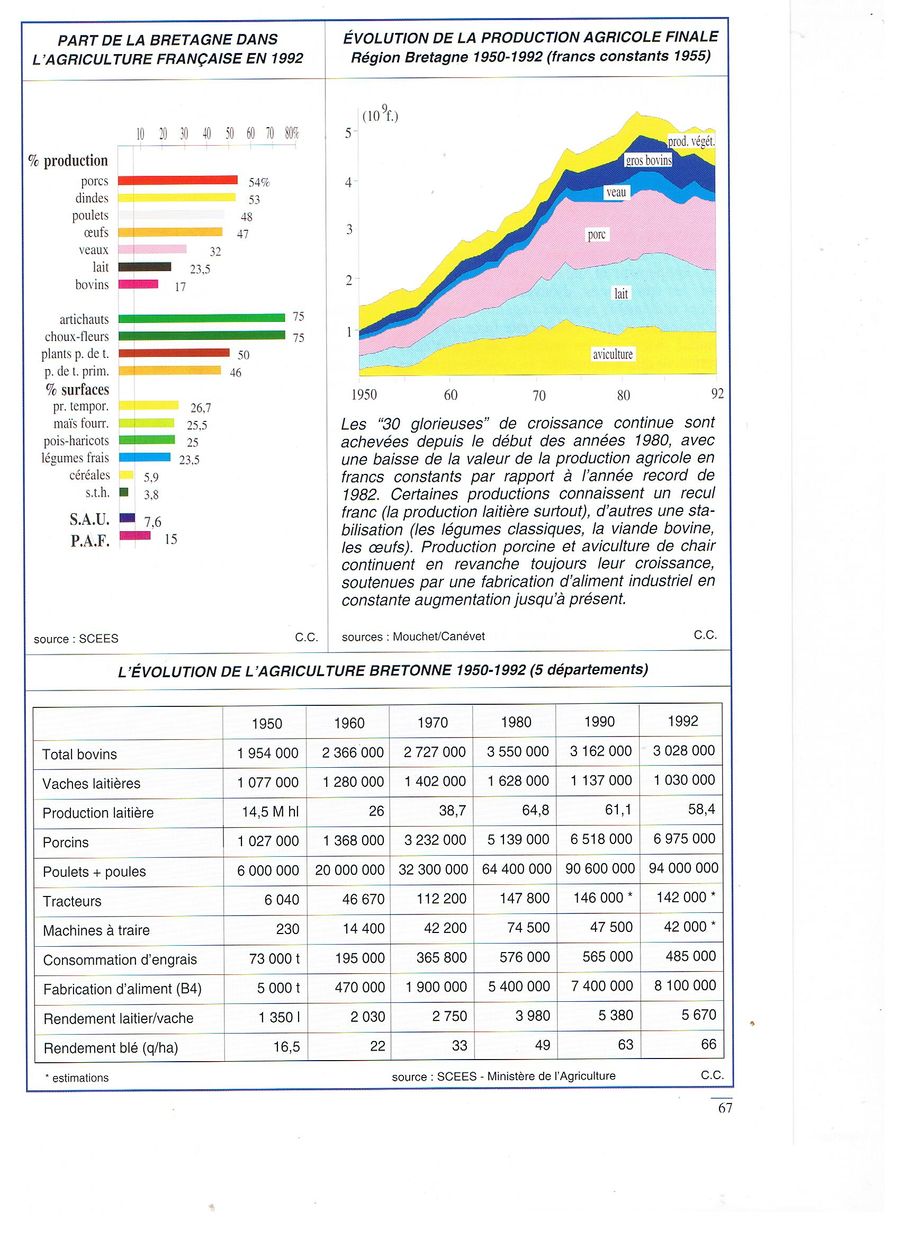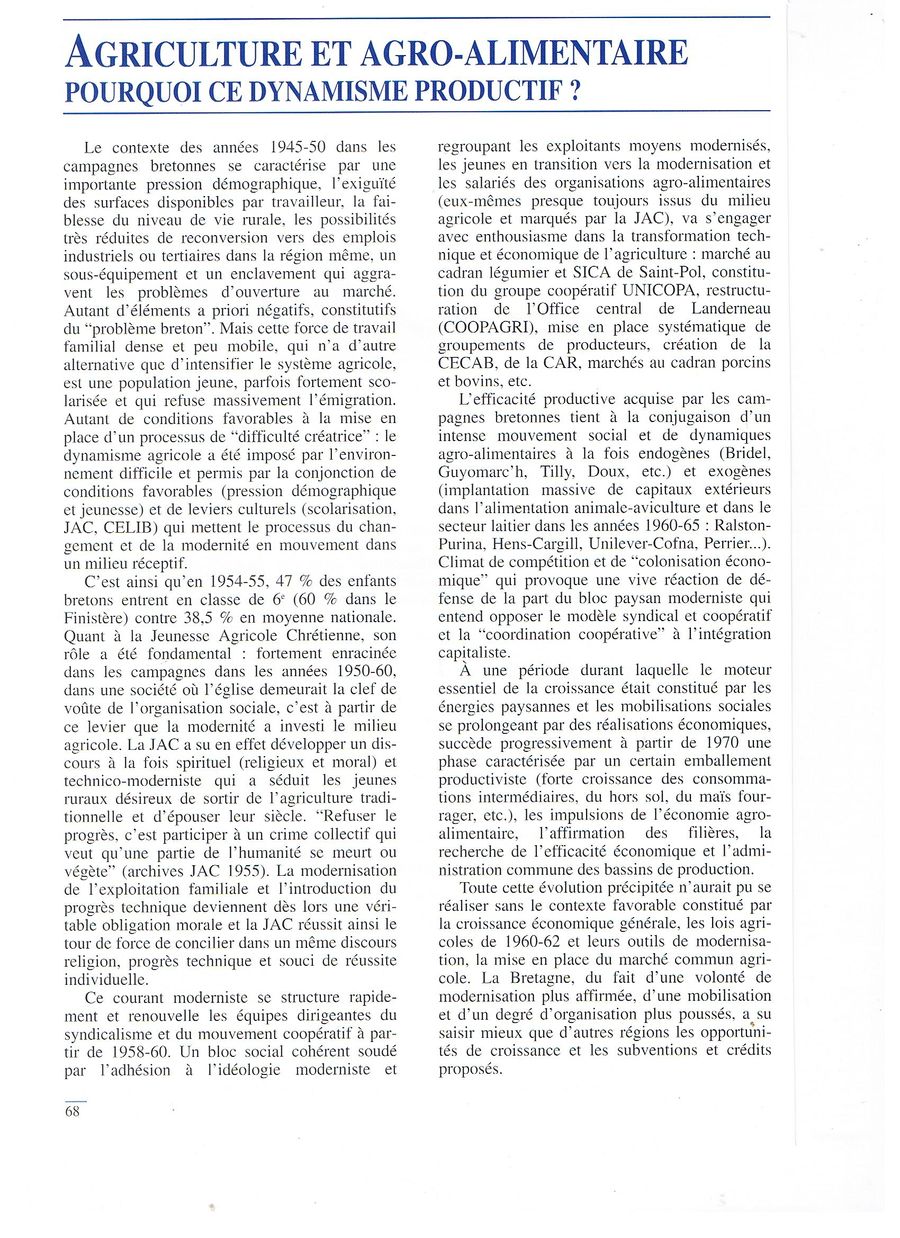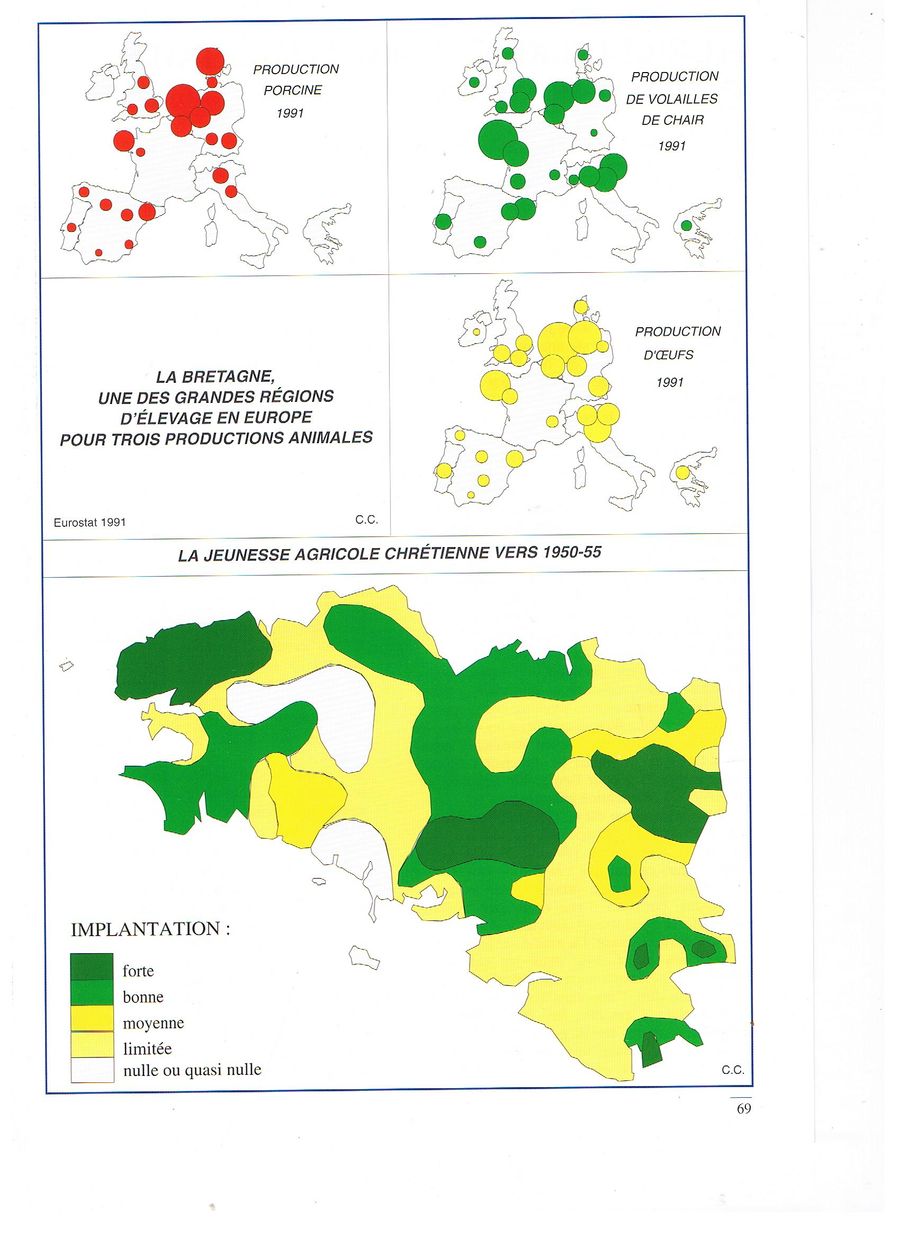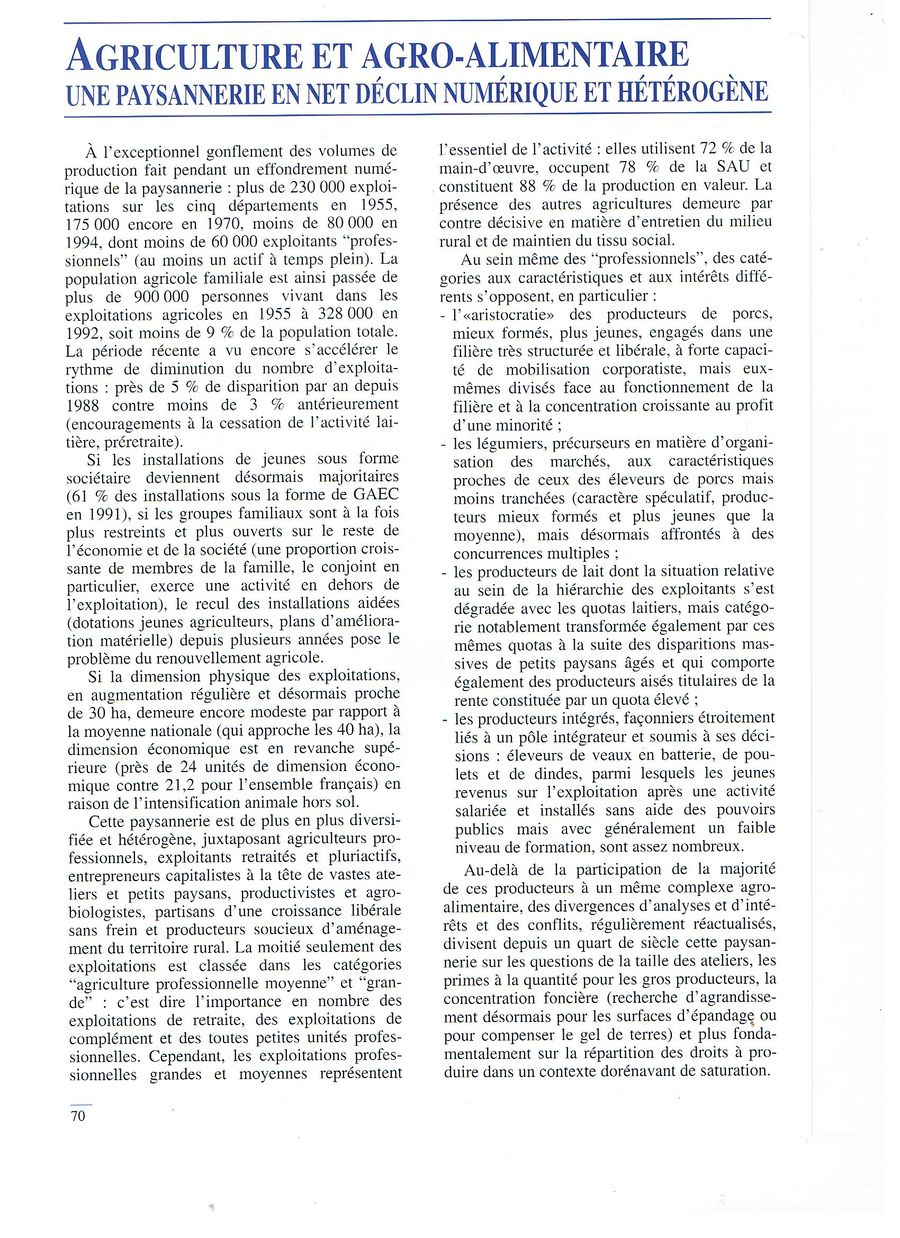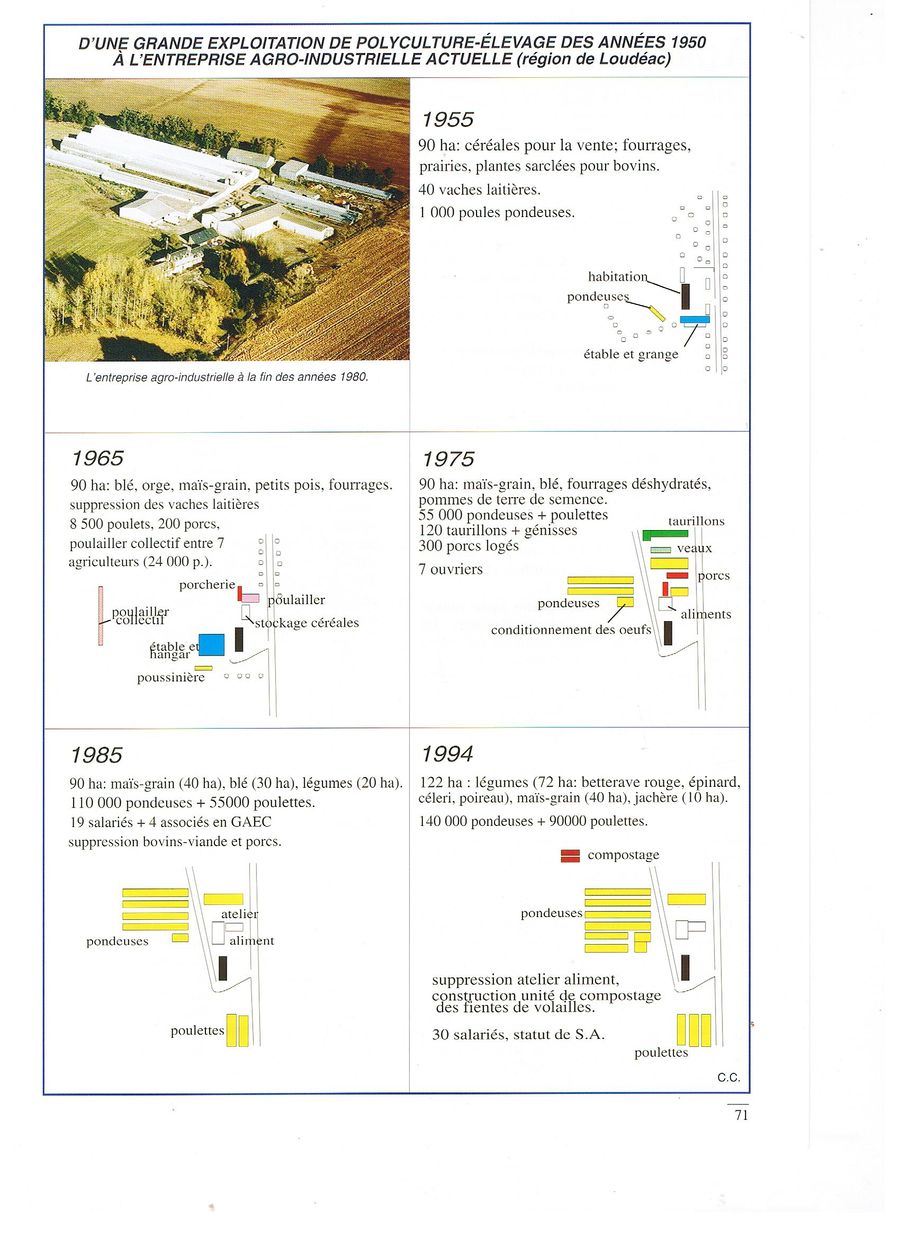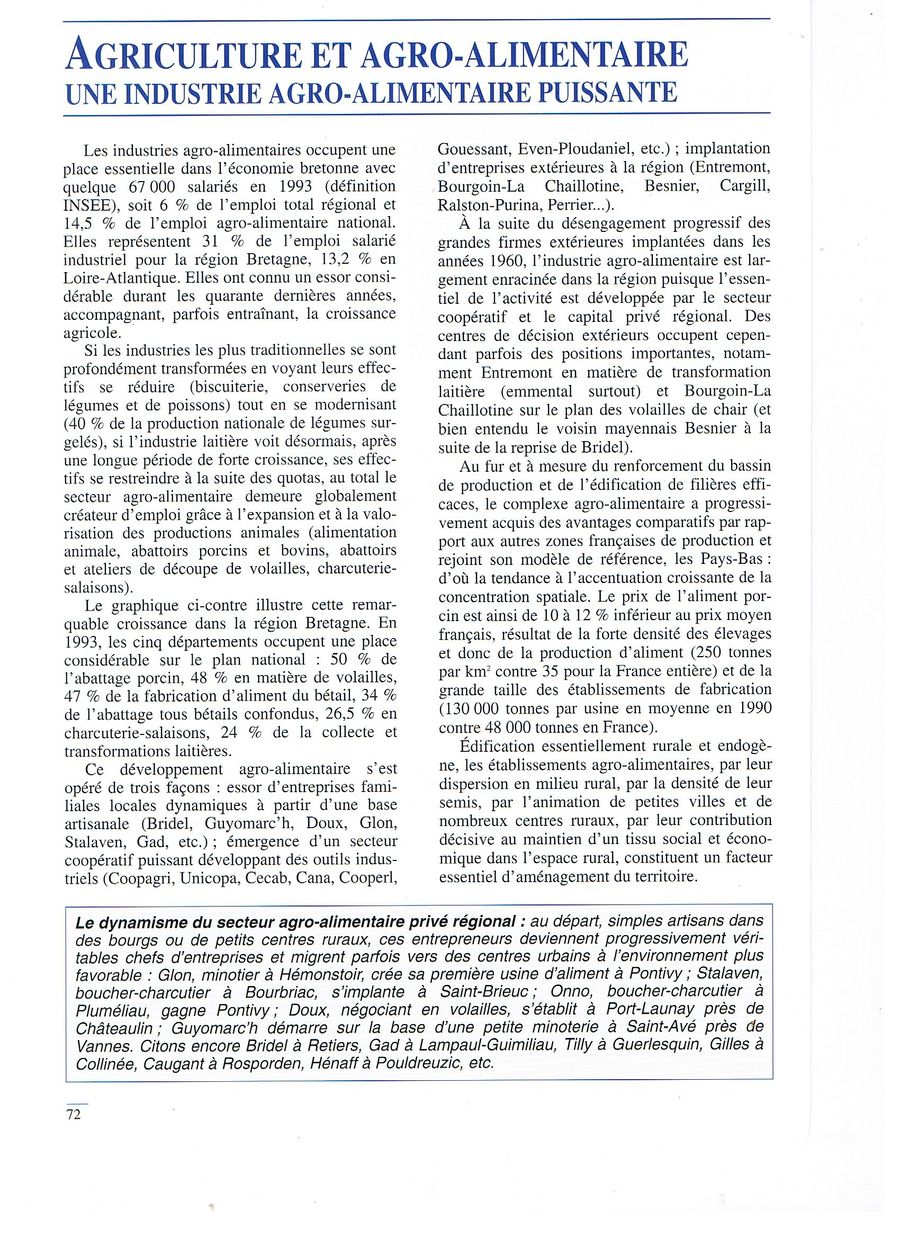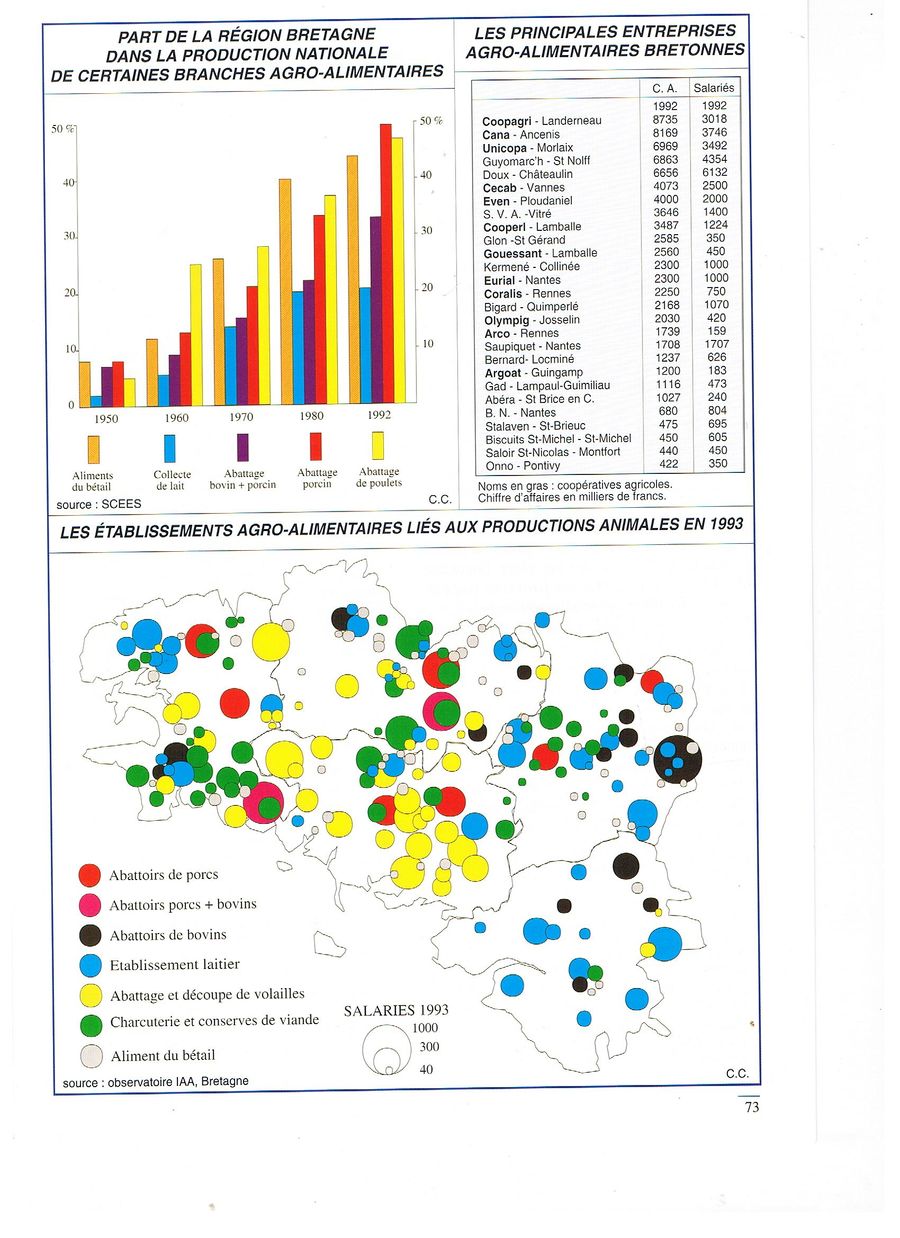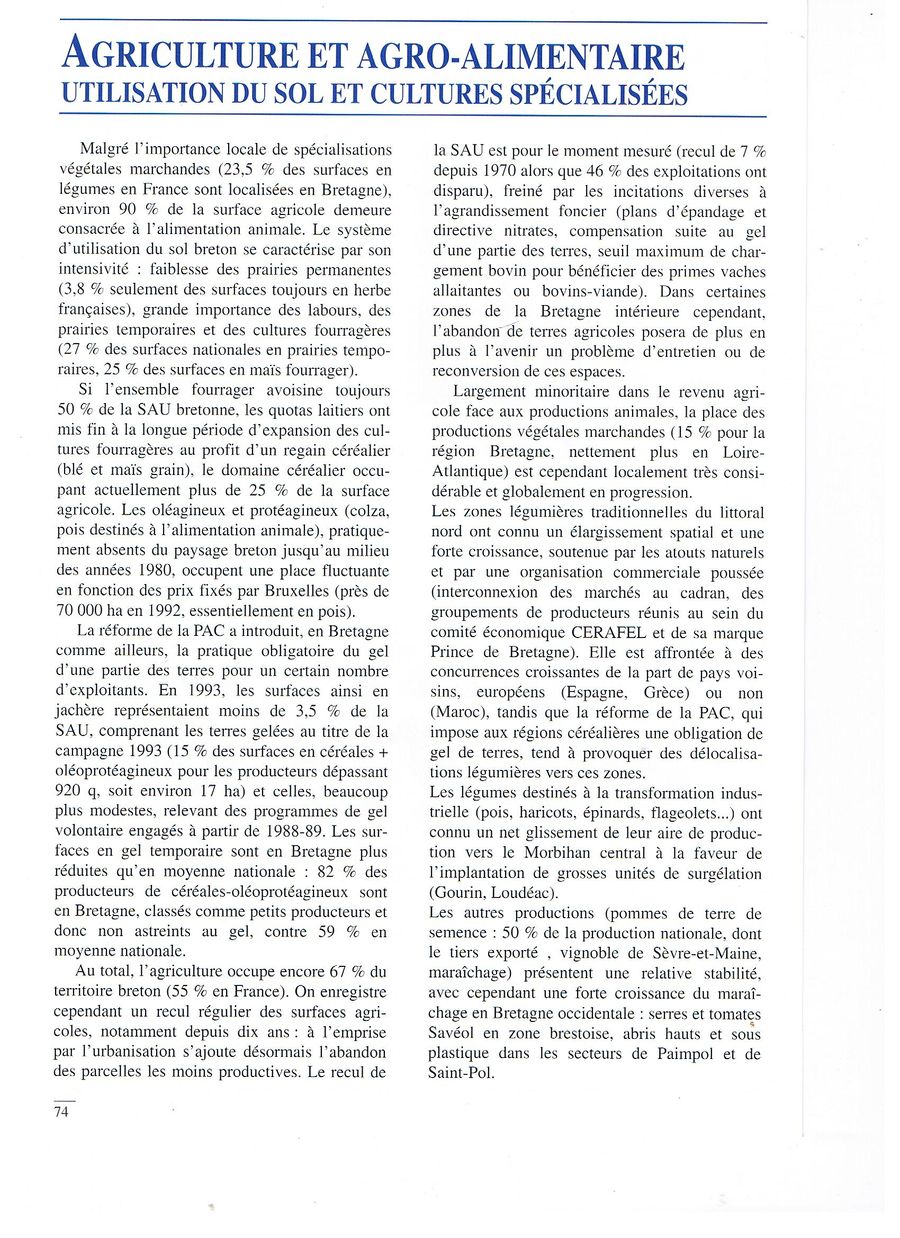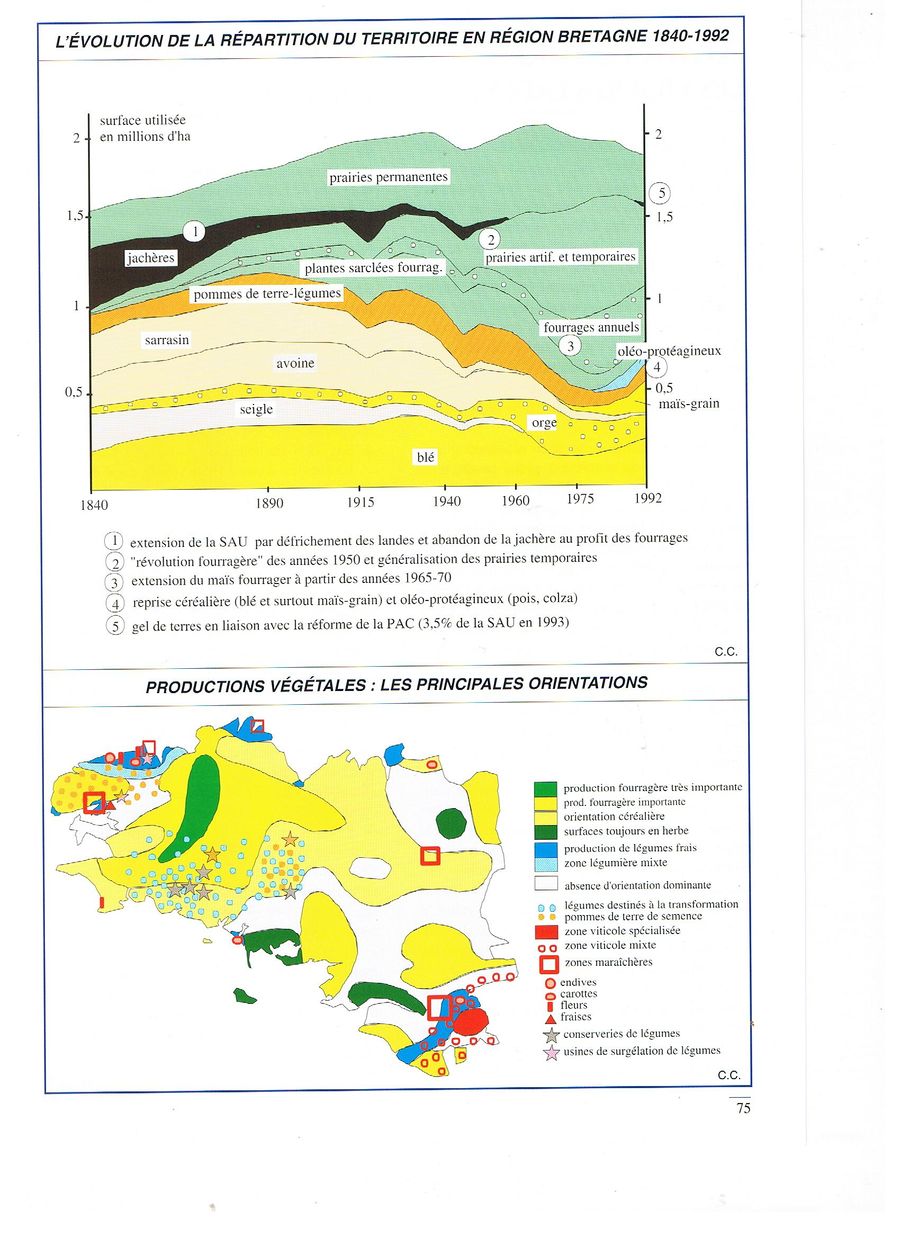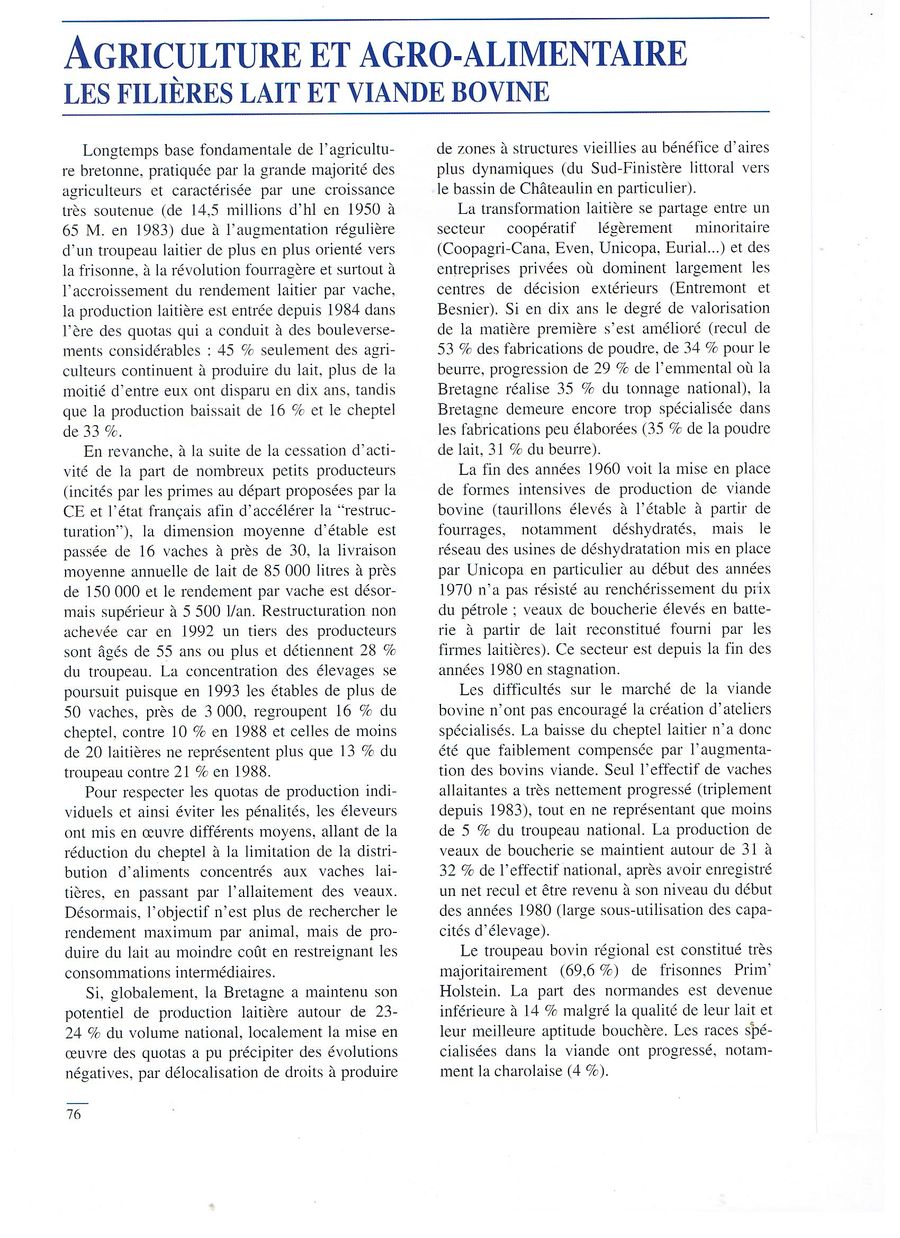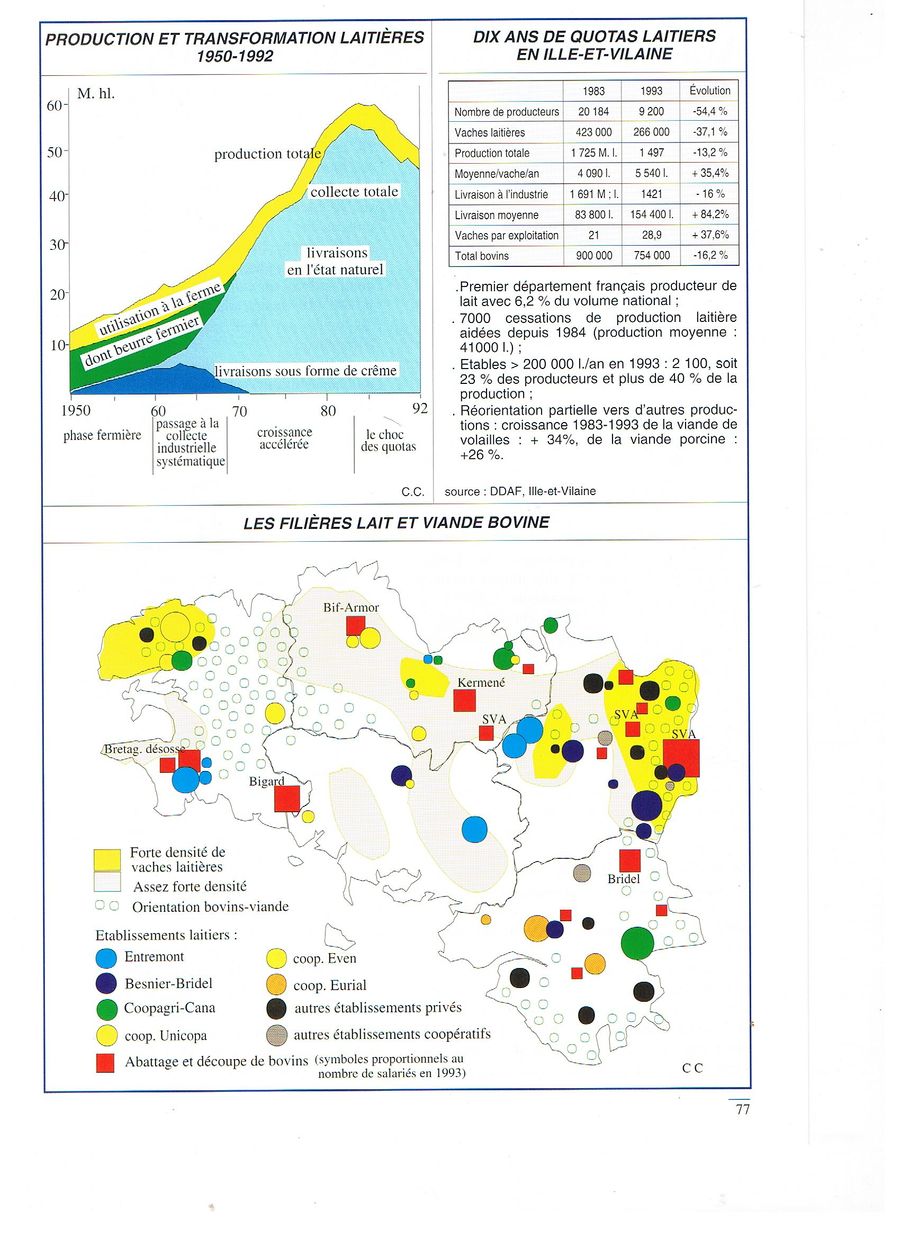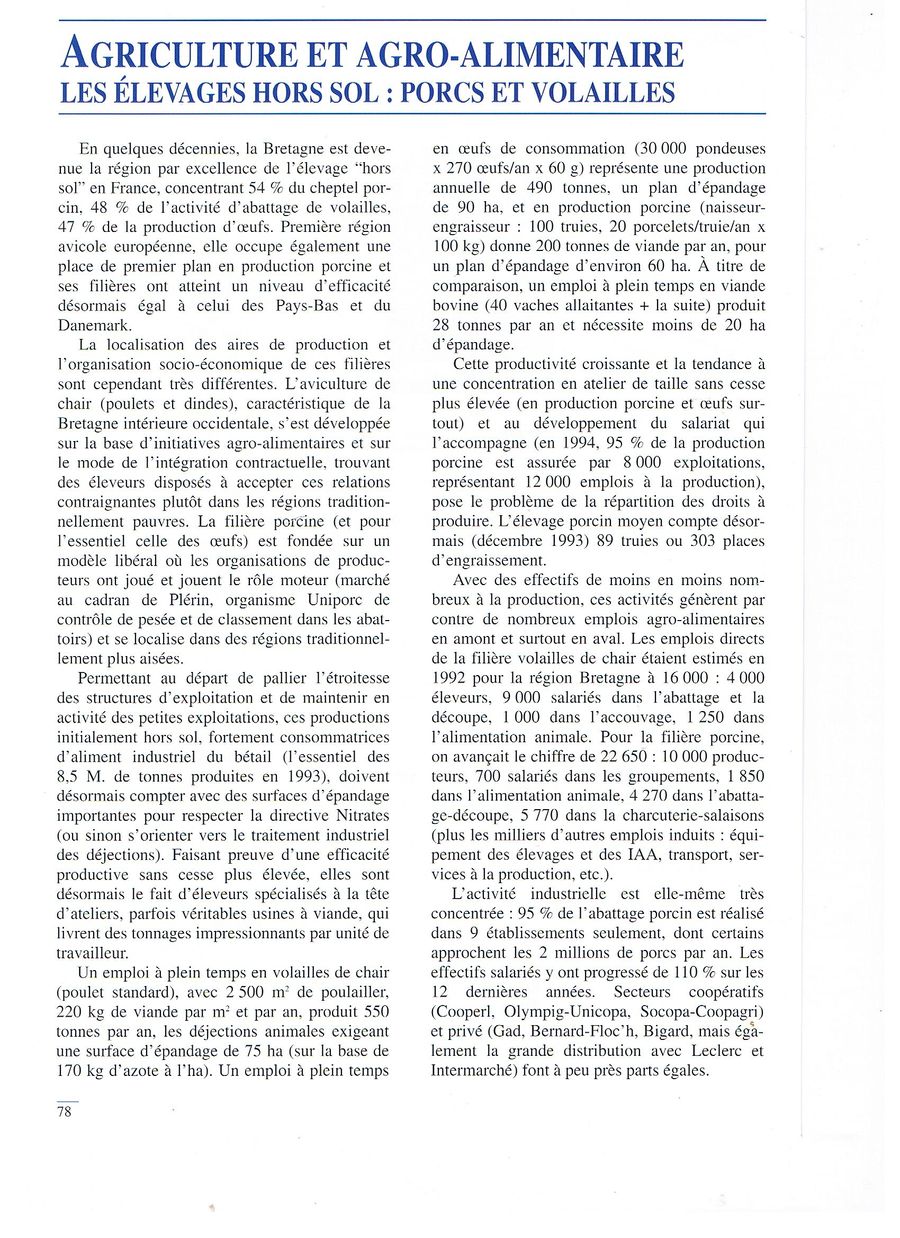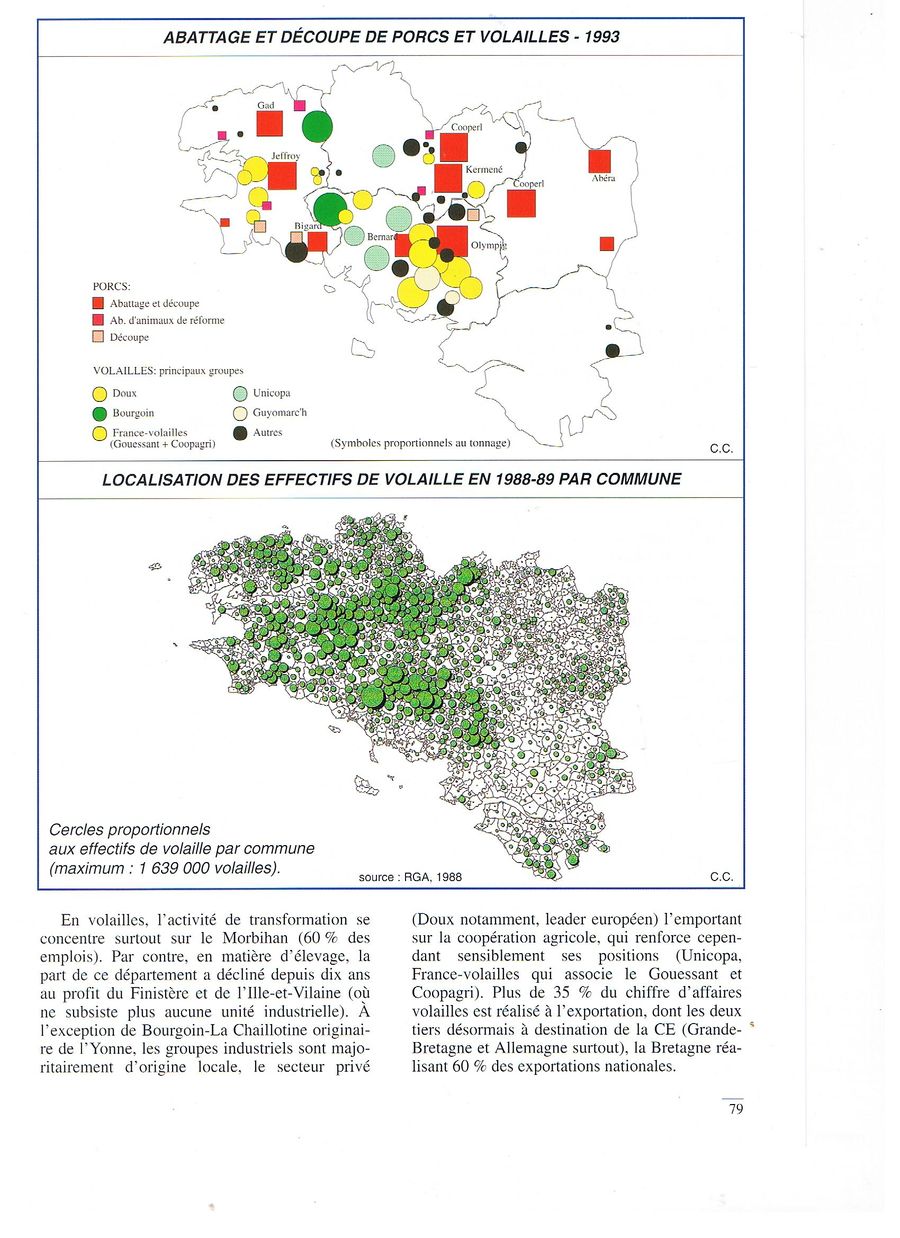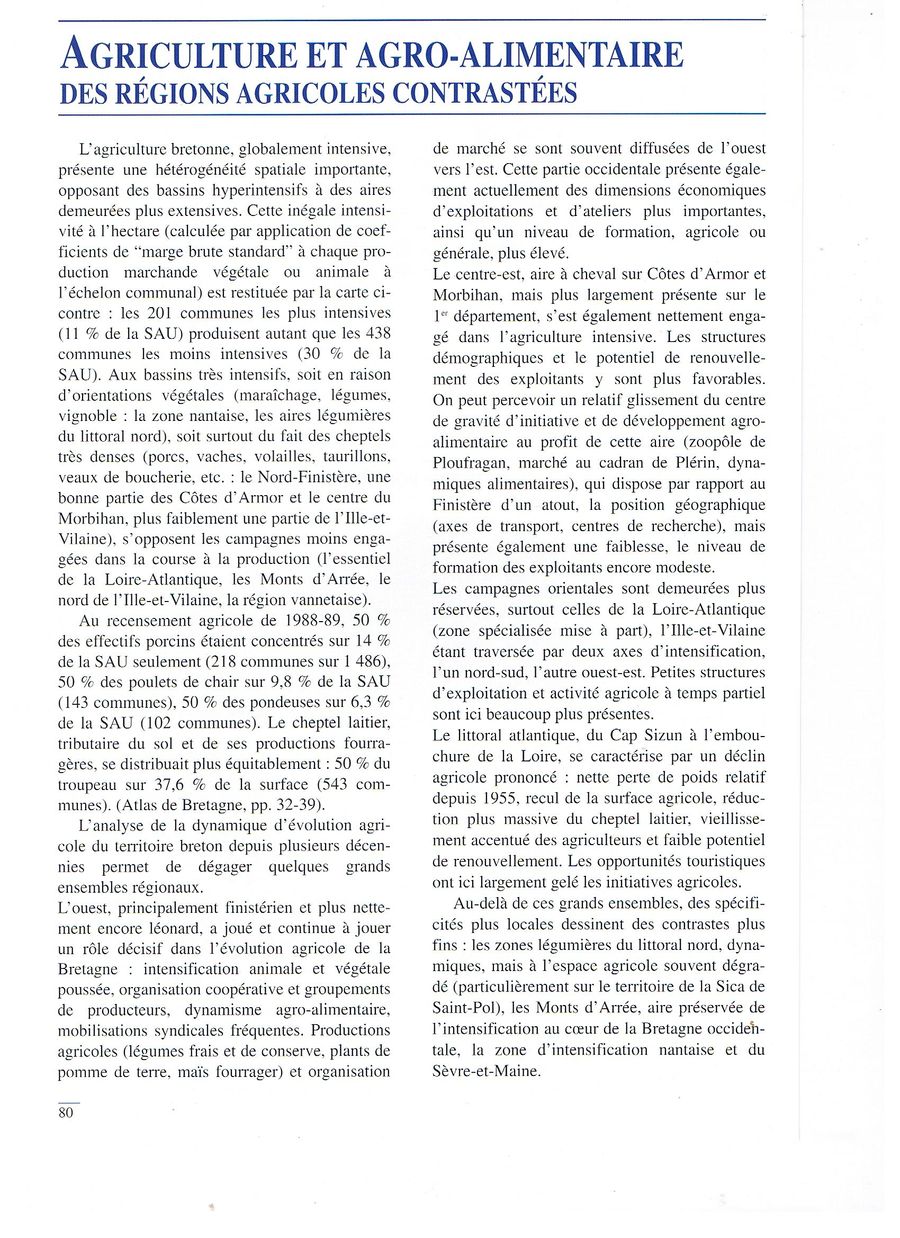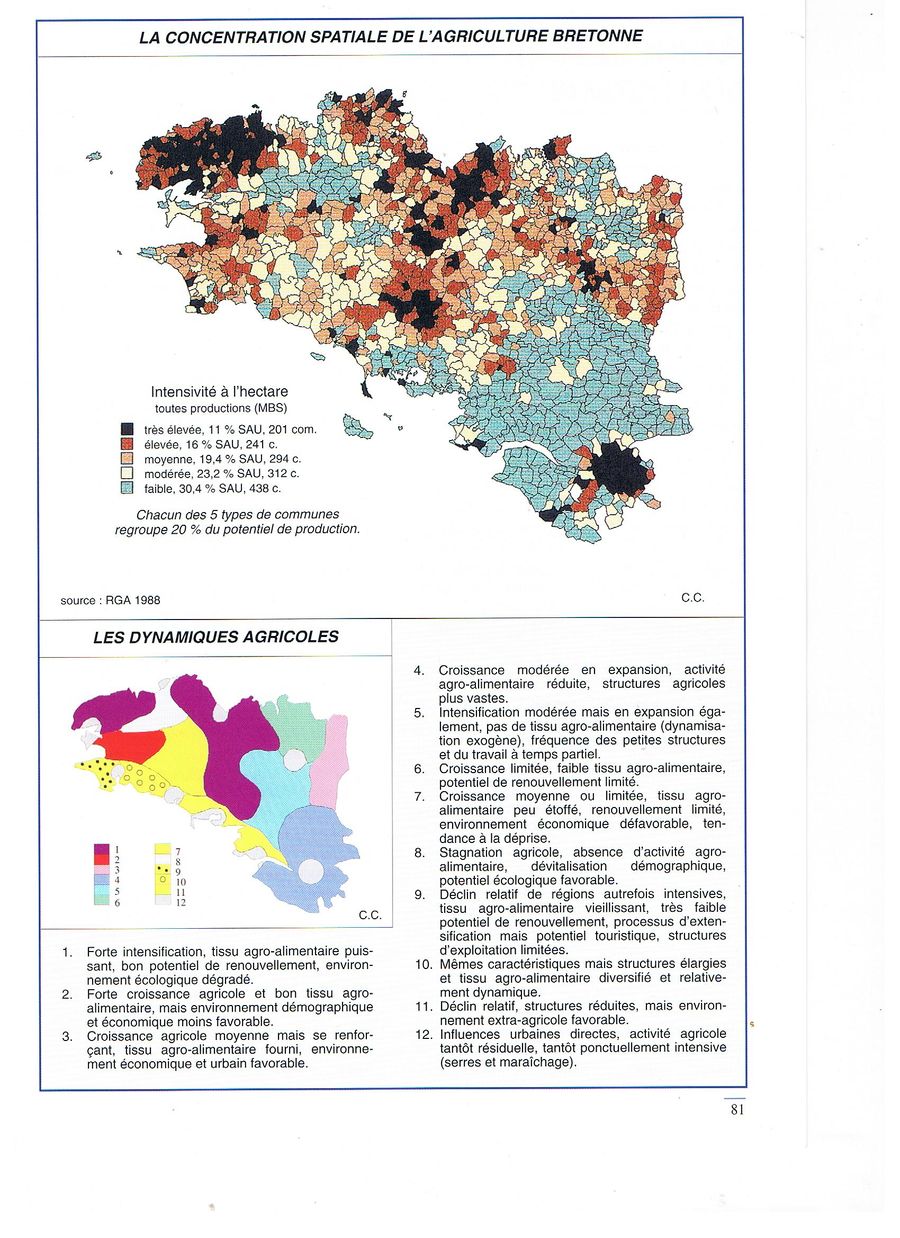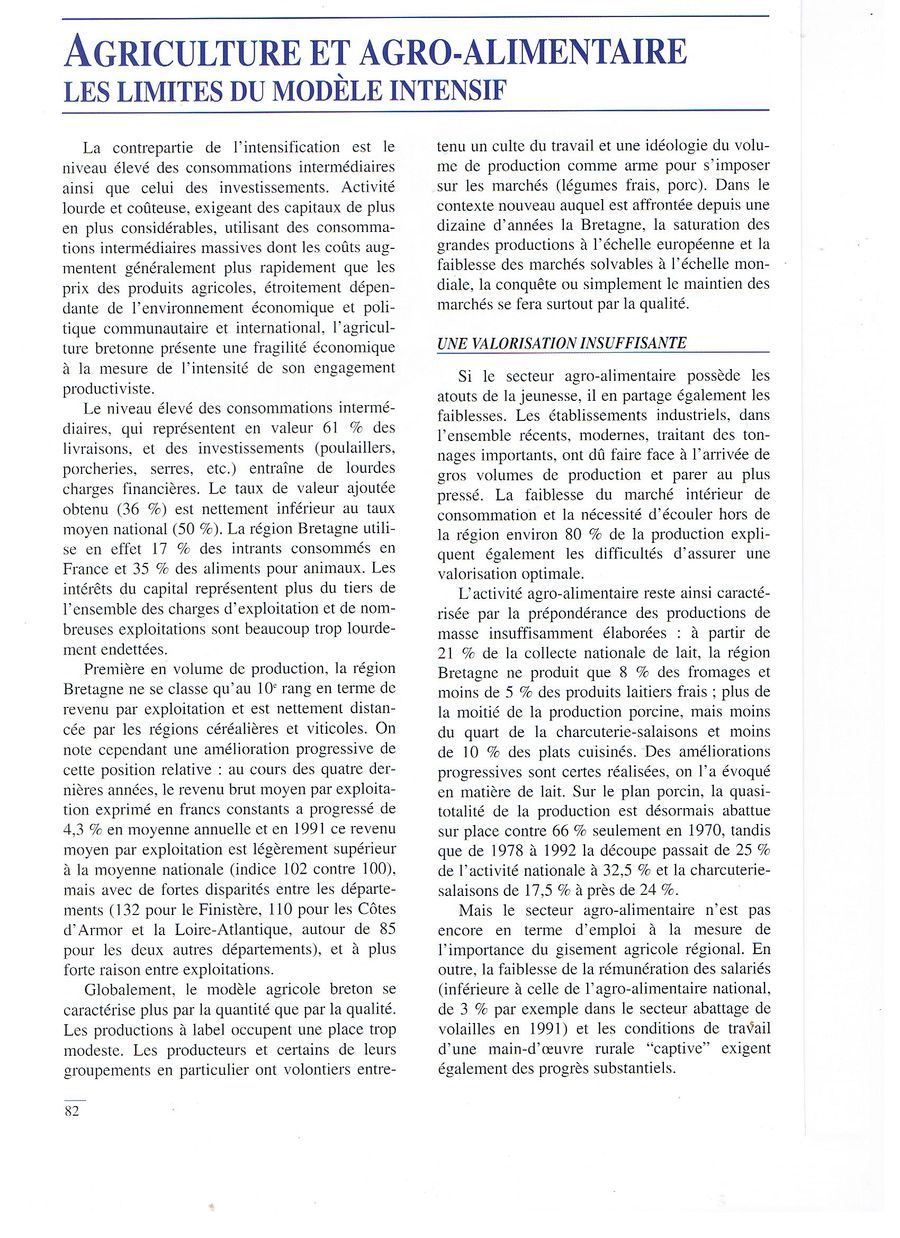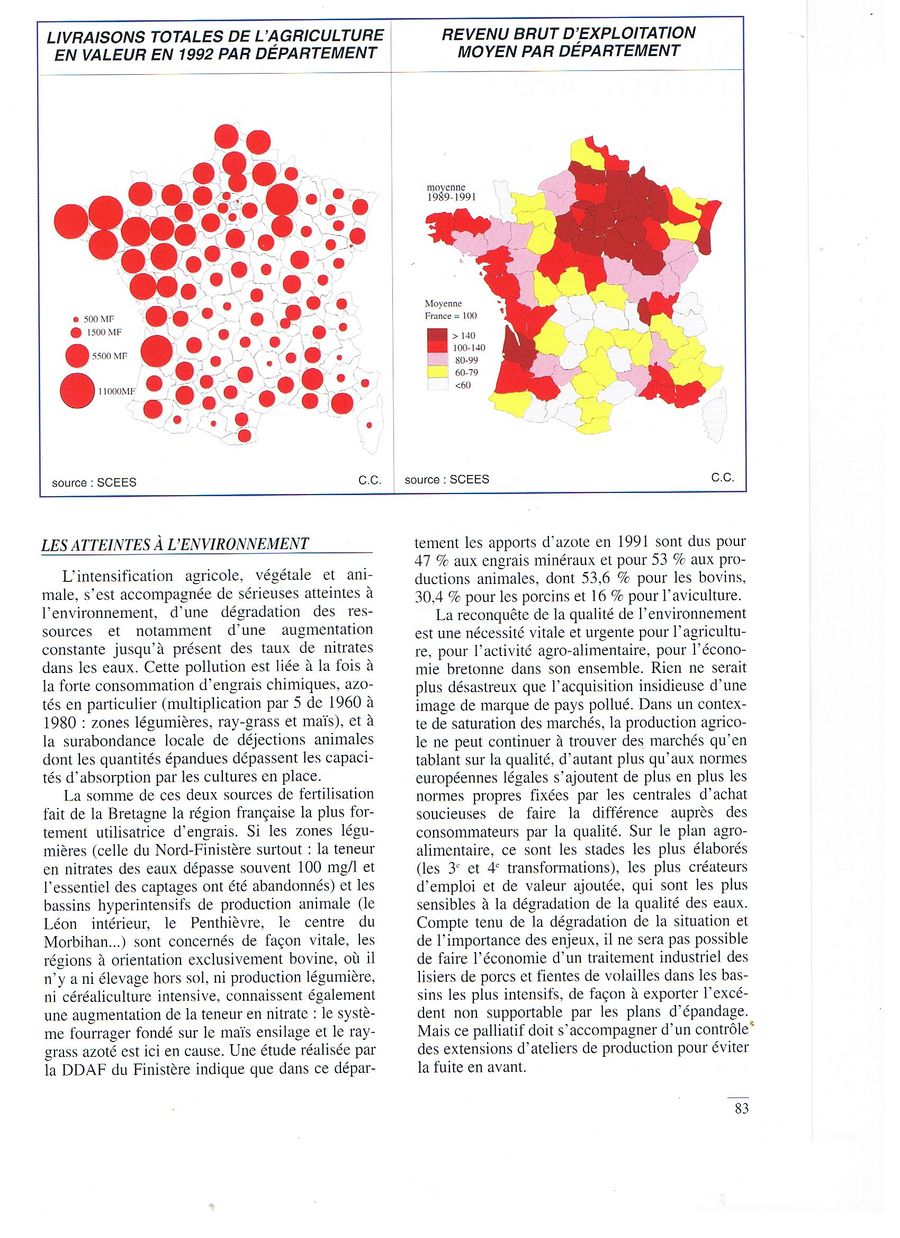Géographie de la Bretagne/Agriculture et agro-alimentaire
Sommaire |
Agriculture et agroalimentaire (1994)
Auteur : Corentin Canévet
Agriculture et agroalimentaire (2014)
Auteur : Renaud Layadi
TIROIR : Bretagne : Une autre économie agro-alimentaire, Vers des modèles plus qualitatifs
Texte collectif de l’association “ Géographes de Bretagne ” 30 mars 2014
Suite aux derniers événements liés aux “ Bonnets rouges ” et à la crise agroalimentaire bretonne, l’association “ Géographes de Bretagne ” souhaite réagir pour contribuer au débat régional. A travers cette prise de position nous n’avons pas la prétention de traiter en quelques lignes toutes les dimensions du sujet, comme toute réflexion géographique l’impose : rôle de l’agriculture dans la transition énergétique, adaptation de l’agriculture au changement climatique, etc… Cependant, parmi d’autres, la question essentielle ici traitée est bien celle du lien de l’agriculture et l’agroalimentaire avec le territoire, car ce lien constitue une parfaite illustration des enjeux de relocalisation pour une politique économique bretonne reterritorialisée.
Et ce nouveau lien doit avoir comme fil conducteur la qualité. La Bretagne doit, en effet, se doter d'une économie agricole plus qualitative, en adéquation avec son image, pour faire vivre ses agriculteurs, valoriser ses territoires et assurer le bien-être de ses habitants. On entend ici par “ qualité ”, un processus de production plus long, plus naturel offrant des produits plus sains, savoureux et respectueux de l’environnement.
Les constats
Quelques constats, en premier lieu, posent le cadre. Ils sont très bien résumés par l’universitaire économiste Mourad Zerrouki : “ la crise agroalimentaire bretonne provient d’une industrie intensive privilégiant des produits à faible valeur ajoutée, un modèle de développement peu adapté aux nouvelles demandes du marché, une crise environnementale mal maîtrisée, une forte concurrence des pays émergents ”.
En effet l’agroalimentaire breton axé sur l’exportation est à bout de souffle, et ce quels que soient les modèles économiques des entreprises issues d’un capitalisme familial ou lié à la spirale des marchés financiers.
Il est même très étonnant, voire alarmant, qu’aucune action structurelle ne soit prévue afin d’anticiper la gravité des conséquences socio-économiques et territoriales dont nous n'avons eues que les prémices. Pourtant si rien n’est fait, ne risque-t-on pas, à l’instar des terrils du Nord, d’inscrire au patrimoine de l’Unesco les cathédrales agroalimentaires qui surplombent nos 4 voies ? Avec ou sans portiques, les enjeux structurels sont ailleurs, la force de l’agriculture bretonne et de son agroalimentaire, indispensable à la Bretagne, est réellement menacée.
Déjà l’espace agricole, composante essentielle de notre identité, est inexorablement grignoté par l’étalement urbain ce qui contribue, de plus, à la diminution du nombre d’exploitations. Leur agrandissement, imposé par les systèmes actuels, est trop souvent l'unique solution recherchée pour le maintien d’un minimum de revenu sans dégradation des conditions de travail. Sur ces seules dix dernières années, 10 % des terres artificialisées en France étaient localisées en Bretagne, laquelle ne représente que 6,2 % du territoire national. Certes des progrès de densification urbaine et de requalification ont eu lieu, mais compte tenu des projections démographiques qui prévoient que de nombreux immigrants voudront s’y installer, ces progrès ne suffiront pas à assurer la place de l’agriculture dans l’aménagement du territoire.
Ainsi à l’échelle de la Région, des Départements et des Intercommunalités, l’affichage des objectifs de protection des terres agricoles doit davantage se traduire dans les actes et précisément dans les outils de planification (PLU, SCOT). Ce message doit être clair pour la profession agricole qui a besoin de sécurité pour investir dans l’avenir. Il doit être clair aussi pour les propriétaires fonciers en attente d’un reclassement des terres agricoles en terres à bâtir. Par ailleurs notre agriculture régionale n’est pas en mesure de rémunérer au juste prix ses agriculteurs dont le niveau de vie dépend trop souvent des subventions publiques. Or, elles vont petit à petit disparaître. Les situations sociales (revenus, conditions de travail) dans les champs comme dans les usines sont de plus en plus préoccupantes. La question de l’importance des suicides est encore aujourd’hui taboue.
Désormais, les agriculteurs ne maîtrisent plus rien dans ce modèle économique éclaté, car ils sont “ pieds et poings liés ” par les prix imposés par la grande distribution et par l’industrie agroalimentaire. Ces dernières, rassemblées par leur préoccupation commune de l’avenir de l’agriculture et de l’économie bretonnes, devraient pourtant tout faire pour accroître la valeur ajoutée de la production, en échange d’une rémunération plus importante, et permettre ainsi de combler l’insatisfaction récurrente des consommateurs en produits locaux authentiques et identifiables, aujourd’hui trop rares et donc si peu accessibles. La dernière enquête Ipsos de 2014 montre qu’un Français sur deux a l’impression de ne plus savoir ce qu’il mange, et que 8 sur 10 cherchent davantage à connaître l’origine du produit avant de l’acheter.
L’activité agricole de la Bretagne est une question de production certes, mais aussi d’alimentation et de santé de ses habitants. Biologique ou conventionnelle, l’agriculture et l’industrie agroalimentaire doivent intégrer en priorité le souci de la qualité nutritionnelle. Le traitement de ce sujet doit être lié avec les perspectives offertes par la demande croissante en produits locaux de qualité identifiés. Or la question de l’alimentation et des débouchés des produits locaux n’est que très peu abordée dans le “ Pacte d’Avenir ”. Pourtant en Bretagne, notamment pour les produits transformés, l’importation de produits agricoles est importante. La grande majorité des poulets consommés dans notre restauration collective provient de pays étrangers alors que l’aviculture régionale est en crise (40% des poulets consommés en France sont désormais importés).
C’est sur ce genre de paradoxe que notre recherche agroalimentaire doit redoubler d’effort et ainsi s’écarter des modèles classiques éprouvés.
Enfin dernier constat, et ce malgré les efforts déjà engagés et les progrès réalisés, les impacts environnementaux et paysagers de nos modèles bretons restent trop importants. Pour autant, l’activité agricole est un facteur essentiel de préservation de la biodiversité et des paysages. Sans elle, il serait difficile de gérer nos talus, prairies bocagères, landes et zones humides… Vécues aujourd’hui comme une contrainte, ces actions de valorisation ne sont pas suffisamment parties intégrantes du modèle économique de nos exploitations et impliqueraient une dotation plus significative offerte par la collectivité aux exploitations effectuant ce travail, comme cela se pratique en Grande Bretagne dans les ESA (Environmentaly Sensitives Areas).
L’agriculture biologique, plus haut degré de l’agriculture écologiquement intensive, est encore insuffisamment développée et ce, principalement, par insuffisance de son organisation économique et des disponibilités foncières faiblement partagées. Cependant, même nécessaire, la conversion à l’agriculture biologique ne va pas de soi. Ne pas intégrer les difficultés des exploitations conventionnelles pour effectuer cette mutation, les stigmatiser parfois, n’est pas faire preuve à leur égard de considération alors même qu’on cherche à les convaincre.
La question de l’environnement est complexe. Elle ne doit pas être réduite à des raisonnements binaires simplistes et à des schémas de responsabilisation unilatérale. Les agriculteurs ont su collectivement s’adapter et répondre aux demandes quantitatives de la société. Ils pourront le faire demain pour satisfaire les demandes qualitatives mais, cette fois, avec tous les autres acteurs concernés, en recherchant la viabilité économique et ce dans le cadre d’une grande responsabilité collective.
Pour le développement durable de la Bretagne, le sort de l’agriculture et de l’agroalimentaire, n’est plus uniquement lié aux décisions des entreprises et des producteurs. C’est d’un élan commun des territoires, regroupant producteurs, transformateurs, distributeurs, consommateurs, associations et collectivités que doit venir le sursaut de toute une Région.
Les Propositions
Pour relever le défi, de nouveaux liens qualitatifs doivent être renoués avec quelques premiers principes ici proposés.
- Une agriculture au service des agriculteurs : face à la crise, ils doivent demain axer davantage leurs revenus sur les services rendus aux territoires, à leurs habitants, et surtout sur la valeur ajoutée de leurs produits. Les marges de manœuvre sont fortes puisqu’en la matière la Bretagne est depuis longtemps en avant dernière position au niveau national. Le maintien d’une agriculture durable devra aussi se reposer sur une plus grande autonomie des exploitations. Aujourd’hui volontairement isolées, et à l’affût de la disparition des voisines pour s’agrandir, elles doivent demain être plus solidaires pour peser sur les marchés et se regrouper avec de vraies coopératives au service des agriculteurs.
- Une agriculture au service d’une alimentation : sécurisante, traçable, saine, accessible à tous, elle doit être source de meilleurs revenus pour les agriculteurs. L’authenticité bretonne, au-delà du slogan touristique, doit être un réel vecteur économique de développement de nos produits locaux et des saveurs de terroirs. Elus, représentants de l’agriculture et de l’agro-alimentaire ne peuvent plus ignorer à ce point, dans ce contexte de crise économique et sociale, le potentiel offert par la reconquête du marché intérieur régional, car les consommateurs souhaitent savoir si les produits qu’ils consomment, sont issus de leur Pays.
Ce marché intérieur mérite d’être mieux connu : quelle est sa réelle part de débouchés par rapport à ceux de l’exportation ? De même quelle est l’importance des produits agricoles importés en Bretagne ? En 2010 les importations des produits des industries agroalimentaires coûtaient à la Bretagne 11.7 milliards d’euros avec un volet important concernant la viande et produits à base de viande. Est-il normal que, pour des raisons probablement financières, la première région agricole de France importe des produits agricoles qu’elle pourrait elle-même fournir ?
- Une agriculture au service des territoires : son avenir économique devra davantage dépendre des décisions locales, partageant ainsi un sort commun avec tous les acteurs d’un même territoire dans et pour lequel l’environnement préservé sera source de plus-value économique. En effet les pollutions agricoles de l’eau (excès de nitrates, pesticides..), sont imposées par les exigences des rendements quantitatifs pour l’exportation. Demain avec un objectif de rééquilibrage qualitatif, ces exigences seront significativement plus faibles, et par conséquent les impacts environnementaux seront assurément amoindris. Par ailleurs, aspect non négligeable, l’emploi s’avère être proportionnellement plus important dans les exploitations dont tout ou partie de la production est destiné à la consommation locale.
- Un secteur agroalimentaire au service de la valeur ajoutée des produits : cette orientation implique une qualification professionnelle optimisée de ses employés. Les entreprises pourront dans ce cadre bénéficier de débouchés commerciaux davantage maîtrisés car plus en lien avec à la demande alimentaire interne à la région.
Combien de drames sociaux faut-il encore attendre pour que les responsables d'entreprises agro-alimentaires anticipent l'évolution attendue des marchés, s'engagent dans de réelles stratégies de développement déconnectées des financements publics, s’orientent vers la recherche de plus de valeur ajoutée, elle qui nous fait tant défaut ?
Certains l'ont déjà compris, mais ils restent trop peu nombreux. Le secteur agroalimentaire avec la grande distribution, la profession agricole, les territoires comme médiateurs et la Région comme fer de lance, doit pouvoir instaurer un nouveau partenariat équitable, pour une nouvelle gouvernance économique solidaire au service de la Bretagne et de ses habitants.
Pour conclure
Il y a, en effet, peu d’activités économiques, comme l’agriculture, à ce point liées à nos territoires et à leur développement durable. C’est pourquoi la nouvelle politique agricole qualitative de la Bretagne doit ouvrir la voie pour que son avenir et ses équilibres ne dépendent plus autant des décisions opportunistes à court terme des marchés. Région attractive pour les activités et les hommes, la Bretagne ne doit plus laisser l’économie seule maître et guide de l’aménagement du territoire, au risque d’accroître les déséquilibres environnementaux, sociaux et territoriaux entre littoral et intérieur, entre l’ouest et l’est, entre la métropole qui rejette en périphérie les plus pauvres et la campagne qui se meurt.
Les communes et les Pays, pour un dynamisme économique local qualitatif, doivent aller au-delà de la simple recherche d’une perpétuelle croissance démographique, laquelle n’est pas toujours synonyme d'amélioration de la qualité de vie ou de bien être des habitants. Il leur faut, là aussi, sortir des schémas de la concentration urbaine synonyme pour beaucoup d’efficacité économique, et mieux centrer leurs politiques de développement territorial sur la qualité des aménagements et des paysages. Pour ce faire, il ne faut pas, en terme d’aménagement aller au-delà de ce que leurs territoires sont capables de recevoir et d'assimiler. Une gestion maîtrisée des espaces est aujourd’hui nécessaire, pour le bien de tous et l’avenir économique de nos territoires dans un objectif inéluctable de développement durable.
Pour cela, il faut sortir les Pays bretons du système concurrentiel, “ à celui qui enlèvera à l’autre telle entreprise ou telle enseigne…. ”. Il y a urgence à rentrer dans une nouvelle ère, pour une émulation solidaire de tous les Pays, et de manière à n’en laisser aucun de côté, que ce soit dans l’agroalimentaire ou dans les autres secteurs économiques, selon les spécificités et les atouts de chacun.
“ Vivre et travailler au pays ”, ce sont tous les Bretons, quel que soit leur lieu de résidence, en ville comme en campagne, qui doivent pouvoir le revendiquer. L’hyper concentration des hommes et des activités en ville et sur le littoral est lui aussi un modèle qui a trouvé ses limites, car il est source d’exclusion et d’altération de la qualité environnementale de nos territoires, pourtant elle-même source d’attractivité.
La Région Bretagne, s’appuyant sur les autres collectivités, avec plus de compétences et de moyens, doit être un acteur économique moteur et fédérateur, capable de faire converger toutes les initiatives et énergies afin de mettre en œuvre cette nouvelle politique. L’objectif serait ainsi de promouvoir une Bretagne soucieuse du développement équilibré de ses territoires, de l’emploi justement rémunéré, notamment dans le secteur agricole et agroalimentaire. C’est à ce prix que la Bretagne pourra maintenir l’extraordinaire richesse de son environnement, de ses paysages ainsi que son identité, piliers essentiels de son économie et de son avenir.
L’économie agroalimentaire et l’agriculture bretonne doivent demain montrer l’exemple d’un secteur d’activité dont le développement est pleinement ancré sur son territoire et respectueux de ses richesses et ses équilibres. La tâche, indispensable, sera longue mais à la portée de la Bretagne. C’est par la force de son intelligence, et de la solidarité qu’elle est capable de générer, qu’elle relèvera le défi d’une agriculture et d’une Bretagne de qualité pour tous.